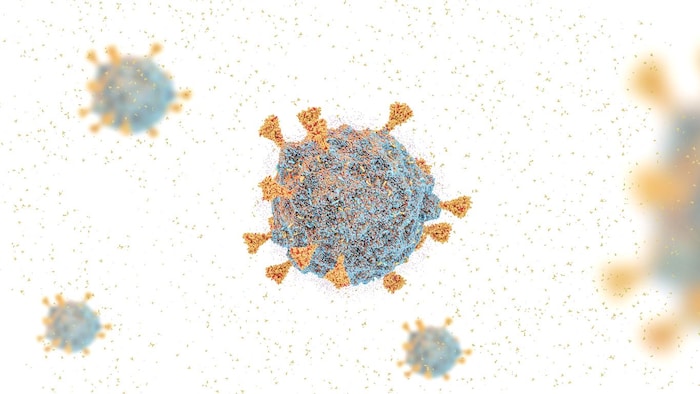Il n’y a actuellement pas de médicament ni de traitement de réadaptation connus qui permettent de guérir la COVID longue. Photo: Getty Images/Asiavision
Palpitations, tachycardie, étourdissements, brouillard cérébral, pertes de mémoire : les symptômes de la COVID longue ressemblent parfois à ceux associés à des problèmes de santé mentale. Ces symptômes existent-ils parce que le virus a un effet physiologique? Ou est-ce la chronicité des symptômes qui pousse les gens à développer des symptômes psychologiques?
Selon le psychiatre new-yorkais Yochai Re’em, la réponse se situe un peu à mi-chemin. Pour certains, leurs problèmes de santé mentale sont exacerbés par le virus; pour d’autres, ils développent ces symptômes pour la première fois
, explique-t-il.
Lorsque les premiers cas de COVID longue ont commencé à apparaître, le Dr Re’em, qui, lui aussi, a eu pendant des mois des symptômes de COVID-19, a cherché à mieux comprendre pourquoi certaines personnes développaient des symptômes dépressifs ou d’anxiété. J’ai été malade pendant des mois. Et après quelques semaines, j’étais confus, témoigne-t-il. Je me demandais ce qui se passait. Pourquoi je ne guérissais pas?
Il savait déjà que des études sur la dépression suggéraient que l’inflammation dans le corps peut, dans certains cas, affecter le cerveau et modifier l’humeur.
Aujourd’hui, de plus en plus d’études montrent que l’inflammation soutenue causée par la présence de fragments de SRAS-CoV-2 semble avoir des effets sur le cerveau et, donc, sur la concentration, l’humeur et la fatigue.
Nous n’en sommes pas sûrs à 100 %, mais cela semble aller dans ce sens. Je n’ai aucun doute que cela joue un rôle dans certains des symptômes psychologiques vécus par les patients de COVID longue
, affirme le Dr Re’em.
Mais parce qu’il n’existe pas encore de tests pour diagnostiquer la COVID longue, de nombreuses personnes continuent de se faire diagnostiquer, à tort, des troubles psychologiques, déplore Carrie Anna McGinn, qui souffre de COVID longue et qui a co-signé, avec le Dr Re’em, un article scientifique sur la santé mentale et la COVID longue (Nouvelle fenêtre).
Il y a beaucoup de gens qui sont stigmatisés. Il y a un manque d’éducation et de compréhension pour toutes les maladies chroniques associées à des infections
, dit Mme McGinn.
Il n’y a rien de pire pour un patient que de se faire dire à répétition que ses symptômes sont inexplicables
, ajoute la psychologue Sonia Ginchereau, qui a sa propre pratique privée et travaille pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Quand ton médecin ne peut même pas t’aider, c’est une impuissance épouvantable. Une citation de Sonia Ginchereau, psychologue
Par ailleurs, souligne-t-elle, les patients souffrant de COVID longue, comme ceux qui souffrent de la maladie de Lyme ou de la fibromyalgie, ont énormément de difficulté à convaincre leurs médecins que leur mal n’est pas dans leur tête.
Il y a beaucoup [de médecins] qui disent que ça n’existe pas [la COVID longue], déplore Carrie Anna McGinn. La COVID longue suscite le même niveau de scepticisme que pour d’autres maladies post-infectieuses. Mais la qualité de vie, et même le pronostic à long terme, dépend d’être cru par le professionnel de la santé.
La psychologue Sonia Ginchereau est l’une des professionnelles de la santé qui, dès les premiers mois de la pandémie, a aidé les premiers patients atteints de COVID longue à obtenir des services de réadaptation.
Si Mme Ginchereau ne traite pas les effets physiques de la maladie, elle s’efforce de diriger les patients vers les bonnes ressources et vers les professionnels de la santé qui comprennent la COVID longue, ou du moins les maladies post-infectieuses.
Il faut travailler d’abord avec le médecin et essayer d’établir un diagnostic clair qui va par la suite aider la personne à aller chercher des ressources au niveau de l’employeur ou des compagnies d’assurance
, dit Mme Ginchereau.
Obtenir le bon diagnostic est d’autant plus nécessaire, puisque les traitements suggérés pour la dépression ou l’anxiété sont généralement bien différents.
Marie* en sait quelque chose. Infectée en novembre 2020, elle souffre encore de divers symptômes post-COVID. On lui a parfois conseillé de s’activer
ou de reprendre son rythme habituel, ce qui a plutôt mené à des crash d’énergie
qui peuvent durer des jours, voire des semaines.
*Marie a souhaité garder l’anonymat, pour ne pas nuire à ses traitements avec ces professionnels de la santé.
Un sentiment d’impuissance qui mène à la dépression et à l’anxiété
S’il y a de plus en plus de preuves que la COVID-19 est l’une des causes de ces symptômes psychologiques, l’incertitude et le manque de reconnaissance de la maladie ont également des répercussions sur le bien-être des personnes souffrant de COVID longue.
D’ailleurs, une récente méta-analyse a montré que certains patients post-COVID étaient 46 % plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires (Nouvelle fenêtre) pendant la phase post-aiguë de la maladie.
Une étude, publiée dans le journal BMC Psychiatry (Nouvelle fenêtre), montre que les personnes souffrant de COVID longue sont environ deux fois plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l’anxiété ou le syndrome de stress post-traumatique, que les personnes qui n’en souffrent pas.
Les gens autour d’eux n’y croient pas. Eux-mêmes ont de la difficulté à y croire. Ils vivent de l’anxiété, des remises en question, un sentiment de perte de contrôle. Puis ça mène à un état dépressif. Et oui, ça peut amener à des crises suicidaires
, dit Sonia Ginchereau.
La majorité de ces personnes ne sont pas suicidaires, croit Mme Ginchereau. Elles veulent s’en sortir, elles veulent trouver des façons de contrôler leurs symptômes. Le désespoir est probablement l’une des choses les plus difficiles à gérer. Il faut les aider à trouver de l’espoir dans cette incertitude.
Carrie Anna McGinn abonde dans le même sens. Elle voit souvent ce type de détresse au sein du groupe de soutien de COVID longue qu’elle gère sur les réseaux sociaux.
Souvent c’est la peine qui est exprimée. Ce n’est pas une volonté de mourir, c’est une volonté d’avoir du soutien adéquat. Une citation de Carrie Anna McGinn
Besoin d’aide pour vous ou pour un proche?
- Partout au Canada : 988
- Au Québec : 1 866 APPELLE (277-3553) (ou par texto : 535353)
- Sur le web : www.suicide.ca (Nouvelle fenêtre)
Pour le Dr Re’em, beaucoup de personnes souffrant – ou qui pensent souffrir – de COVID longue se sentent isolées, incomprises et seules. Peu à peu, elles perdent confiance en elles et ressentent d’énormes frustrations de n’avoir ni réponse ni aide.
Marie* fait d’ailleurs partie de groupes de soutien en ligne, même si un professionnel de la santé le lui a déconseillé. Il m’a dit que d’être dans un groupe pouvait entretenir nos symptômes. Mais, au contraire, ça m’aide beaucoup. Le groupe me confirme que je ne suis pas seule.
De nombreuses personnes ont dû mettre leur vie sur pause, raconte Mme Ginchereau. Ils sont en mode attente, mais entre-temps, leur vie passe. Il faut des interventions pour les aider à reprendre une vie qui va sûrement être différente de celle d’avant, mais plus intéressante que d’être simplement sur pause.
Et c’est sans compter les répercussions sur la vie conjugale, la vie familiale, la vie sociale et la vie professionnelle, soulignent Mme Ginchereau et Mme McGinn.
Il n’y a pas vraiment un filet de soutien social et financier adéquat pour les personnes qui sont malades
, dit Carrie Anna McGinn (Nouvelle fenêtre), qui ajoute que les familles vivent elles aussi de grands bouleversements quand un de leurs membres ne peut plus contribuer aux tâches quotidiennes.
Malgré les nombreuses embûches vécues par les personnes souffrant de COVID longue, Sonia Ginchereau tient à leur rappeler qu’il y a de l’espoir. C’est difficile à faire parce que ça confronte la personne à faire des deuils et à s’adapter. Mais il y a des moyens de mieux vivre malgré la maladie.
Avec Radio-Canada par Mélanie Meloche-Holubowski