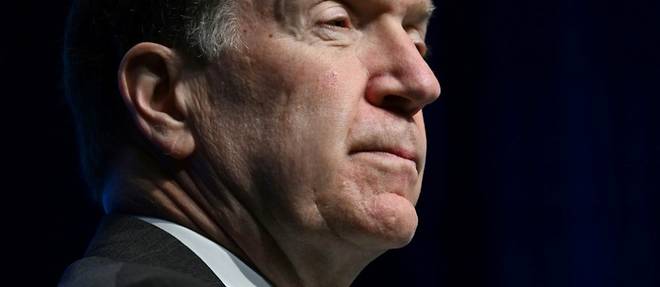Selon la Banque mondiale, les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont augmenté d’environ 3,8 % en 2023. Pour l’Afrique, la tendance devrait encore s’accélérer en 2024.

Six cent soixante neuf milliards de dollars. C’est la somme, colossale, en progression de 3,8 % par rapport à l’année dernière, envoyée par les immigrés vers les pays à revenu faible et intermédiaire en 2023, selon des estimations de la Banque mondiale. Dans un rapport publié le 18 décembre, l’institution basée à Washington explique cette progression par « les marchés du travail résilients des économies avancées et des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ».
Les flux d’envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne devraient avoir augmenté d’environ 1,9 % en 2023 pour atteindre 54 milliards de dollars, grâce à une forte croissance des envois de fonds au Mozambique (48,5 %), au Rwanda (16,8 %) et en Éthiopie (16 %). Les transferts vers le Nigeria, qui représentent 38 % des flux d’envois de fonds vers la région, ont augmenté d’environ 2 %, tandis que deux autres bénéficiaires importants, le Ghana et le Kenya, ont affiché des gains estimés à 5,6 % et 3,8 %, respectivement.
En Afrique de l’Ouest, le premier pays bénéficiaire de ces flux est le Sénégal avec près de 3 milliards de dollars, soit 9,4 % du PIB du pays. La Côte d’Ivoire a reçu 446 millions de dollars, le Mali 1,1 milliard (5,4 % du PIB) et le Burkina Faso, 579 millions. En Afrique centrale, exception faite de la RDC qui a bénéficié de transferts pour un montant de 1,3 milliards de dollars en 2023, les flux sont bien plus modestes : 375 millions de dollars vers le Cameroun, 18 millions à destination du Gabon et seulement 3 millions pour le Congo.
Progression au Maghreb
« Les taux de change fixes et les contrôles de capitaux détournent les envois de fonds vers la région des canaux officiels vers les canaux non officiels », note la Banque mondiale. En 2024, les flux d’envois de fonds vers la région devraient poursuivre sur cette tendance et augmenter de 2,5 %.
En revanche, les envois de fonds vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont diminué en 2023, chutant d’environ 5,3 % pour atteindre 61 milliards de dollars en 2023, principalement en raison d’une forte baisse des flux vers l’Égypte. Malgré tout, la diaspora continue de soutenir ses proches au Maghreb, les flux d’envois de fonds vers la zone ayant enregistré une hausse. À noter, notamment, une forte progression des flux vers le Maroc, qui atteignent 12,1 milliards de dollars (+8,6 %), soit plus de 8 % du PIB. Les transferts vers l’Algérie représentent 1,8 milliard de dollars et s’élèvent à 2,7 milliards en direction de la Tunisie.
Émissions obligataires ciblées
« Pendant les crises, les migrants ont fait preuve de résilience pour soutenir leurs familles restées au pays, explique Iffath Sharif, directrice emploi et protection sociale à la Banque mondiale. Mais l’inflation élevée et la faible croissance mondiale affectent la quantité d’argent qu’ils peuvent envoyer ». Selon l’experte, « les politiques de protection sociale des pays d’accueil devraient inclure les migrants, dont les envois de fonds constituent une bouée de sauvetage vitale pour les pays en développement ».
Les flux de transferts de fonds vers les pays en développement ont dépassé la somme des investissements directs étrangers et de l’aide publique au développement ces dernières années. Par exemple, en 2023, les envois de fonds des travailleurs migrants devraient surpasser d’environ 250 milliards de dollars le montant des investissements directs étrangers (IDE) réalisés dans leurs pays d’origine.
Alors que l’écart continue de se creuser, « les transferts de fonds doivent servir de levier à la mobilisation de capitaux privés pour soutenir le financement du développement, notamment par le biais d’émissions obligataires à destination de la diaspora », propose Dilip Ratha, économiste en chef de la Banque mondiale et auteur principal du rapport.
Avec Jeune Afrique par Thaïs Brouck